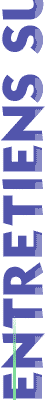
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURL'Enfant et le mythe (1) Comme un mirage ou comme un feu follet le mythe trompe, et au lieu de donner courage il rend la réalité plus difficile à vivre, plus grise qu'elle ne l'était auparavant. Nous nous imaginons trop souvent que l'enfant bien nourri, bien vêtu, et qu'on ne maltraite jamais, est forcément heureux. Tous les enfants ont des besoins, des aspirations, des désirs que la réalité ne peut satisfaire. Tant que l'enfant est tout petit, un charmant bébé, il est le centre de la vie familiale, on s'occupe de lui presque continuellement. Mais nombreux sont les cas où peu d'années après, l'enfant est, par la force des circonstances, très souvent livré à lui-même. En vient-il un nouveau, qui absorbe le temps et le meilleur de l'attention de la mère, ou bien celle-ci est-elle forcée par son travail de laisser seuls les enfants, bref, le petit qui ne va pas encore à l'école, ressent souvent douloureusement sa solitude. J'ai connu, une fillette, la cadette d'une nombreuse famille et que sa santé retenait loin de l'école communale. Ses parents vivaient à la campagne, et l'enfant après les courtes leçons que lui donnait sa sÅ“ur aînée, était laissée à elle-même dans le jardin, des heures durant. Douée d'une très vive imagination, elle ne semblait pas souvent à court d'idées, et inventait sans cesse de nouveaux amusements. Elle avait réussi à apprivoiser une jolie grenouille verte, et collectionnait des vers de terre! Enfin on l'entendait parfois causer toute seule et rire comme si ses jeux avaient eu un spectateur. Pressée de questions, elle raconta qu'une fillette nommée Lucie, venait jouer avec elle, mais se sauvait si quelqu'un s'approchait. Il va sans dire que Lucie était un personnage absolument fictif, créé de toutes pièces par le subconscient de la petite isolée. Voilà le mythe compensateur. De très bonne heure l'enfant cherche à échapper à la réalité, trop terne ou trop triste pour lui. Sa fantaisie n'est jamais bridée par l'impossibilité de ce qu'il imagine, comme l'est la nôtre. Il ne contrôle pas ses créations subconcientes, et ne les passe pas au critère de la réalité plausible. Il les accepte comme elles se présentent à lui pour peu qu'elles satisfassent la logique qui est la sienne, et qui ne procède pas suivant les mêmes règles que la nôtre….. Il y a menteur et menteur. Le petit enfant qui invente des histoires, qui raconte qu'on lui a promis une poupée ou un cheval de bois, n'est pas pour cela un menteur. Il ne distingue pas clairement la vérité de la fiction qu'il se raconte à lui-même, et qui n'est que l'expression de ses désirs. Poussés par des motifs très divers, une foule d'enfants agissent ainsi. La réalité les ennuie, et ils la tranforment au gré de leur fantaisie, n'ayant pas comme l'adulte le pouvoir de modifier en quelque mesure cette réalité ou d'introduire un élément d'intérêt. Les enfants élevés seuls, ou ceux que leur santé débile retient loin des jeux de leurs camarades, risquent fort de suppléer ainsi à la monotonie de leur existence… Ne distinguant plus nettement la vérité du mensonge, ils se servent alternativement de l'un ou de l'autre pour étonner, attendrir ou émouvoir… Comment corriger le petit rêveur et l'enfant créateur de mythes? J'avoue franchement que je considère ce traitement comme un des plus difficiles que puisse nous réserver une éducation. Pourquoi l'enfant se réfugie-t-il dans le mythe? Parce que sa réalité ne lui semble pas intéressante; et c'est en grande partie la faute des éducateurs. S'il est forcément élevé à l'écart, loin des enfants de son âge, il faut remplacer par autre chose, la source d'intérêt passionnant que sont les jeux en commun. C'est là le secret de sa santé morale. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est une impossibilité, qu'on n'y peut rien. Il faut trouver moyen non pas toujours de l'amuser, mais de l'intéresser. Nous vivons dans un monde débordant de sujets d'intérêt, mais seul, l'enfant ne le découvre pas.. Il faut lui enseigner à se servir de ses yeux, à regarder, à sympathiser. A la campagne, la vie de la nature est une source inépuisable de leçons de choses, dont il peut faire son profit, sans fatiguer ses méninges. Mais pour cela, il faut un intermédiaire entre l'enfant et la nature, jusqu'à ce qu'il ait appris à voir, à observer. Laissé seul en face de la nature, il la peuplera des créations de son imagination, il mettra des dragons dans les cavernes, et des fées dans les forêts. Il est voué au mythe, si personne ne sait éveiller en lui le sens de la réalité. Ce que nous disons concerne plus spécialement l'enfant élevé à la campagne, à proximité d'une ville, où se fera plus tard son éducation et se dessinera sa carrière. Mais qu'en est-il des enfants des cultivateurs, qui très jeunes sont déjà associés aux travaux des champs? Ces enfants là, courent-ils le danger de devenir des faiseurs de mythes? Là vie du campagnard est tellement la plus normale, la plus saine physiquement, que nous voudrions pouvoir, répondre négativement à cette question, mais de récentes expériences nous ont prouvé que justement dans nos campagnes reculées, et dans nos villages de montagne, on rencontre des enfants mythomanes et d'autres dont le sens de la vérité est absolument faussé. D'où cela peut-il venir? Au village, les parents paysans ont très peu de temps à consacrer à l'éducation de leurs enfants et s'en remettent à l'école pour tout le travail éducatif. Levée avant l'aube, la mère doit toujours courir au plus pressé, de la basse-cour au jardin potager, de la cuisine aux champs. Une fois le rude labeur terminé, on va se coucher de bonne heure pour reprendre courageusement le travail avant le jour. L'enfant robuste qui peut prendre part à la vie de la ferme, et fréquenter à côté de cela l'école, a moins à craindre qu'un autre le danger du mythe. Mais nous trouvons au village comme à la ville des enfants qui ne sont pas forts, des jeunes filles qui ne peuvent prendre part aux travaux de la terre; ces enfants-là, sont très exposés au danger que nous avons signalé. La nature en face de laquelle ils se trouvent d'un bout de l'année à l'autre, ne leur dit pas grand'chose. Les livres sont rares, les sujets d'intérêt intellectuel très clairsemés. Les jeunes qui ne travaillent pas aux champs sont désoeuvrés, rêvassent, et sont souvent la proie de la superstition et de l'irréalité. Les parents villageois qui ont à coeur le développement moral de leurs enfants devraient attacher une importance bien plus grande qu'ils ne le font généralement aux distractions et aux jouissances intellectuelles dont leurs enfants ont besoin, tout comme ceux des villes. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet; dans nos villages les parents devraient avoir à coeur d'utiliser les bibliothèques existantes, au besoin d'en créer ou de les enrichir, de prendre intérêt aux occasions qui leur sont offertes de se développer intellectuellement (conférences, etc.). Nous parlions de superstition ce n'est pas là un vestige du passé; on rencontre aujourd'hui des jeunes gens et des jeunes filles dont la vie est empoisonnée par des terreurs superstitieuses, qui croient encore aux maléfices, aux sortilèges, aux démons familiers et… qui tremblent en passant devant le cimetière une fois le soleil couché etc. Les livres de magie n'ont pas encore été tous mis dans nos musées comme d'intéressants témoins d'un autre âge, et je sais un village où les haricots doivent être semés suivant un rite spécial… et où les entorses sont guéries par des formules magiques… Comment l'enfant élevé dans un milieu de ce genre, et dont personne n'a le temps de s'occuper, ne tomberait-il pas en proie au mythe et à la rêvasserie? Lui confier une tâche pratique proportionnée à ses forces et impliquant une certaine responsabilité, ne serait-ce pas remédier à cet état de choses? Elever un enfant en contact avec la nature est un grand privilège et la tache de l'éducateur en sera singulièrement simplifiée. Mais l'enfant des villes n'est pas pour cela condamné à tomber en proie à l'irréalité. A côté de la nature il y a l'homme, et l'enfant de la ville a l'avantage de vivre plus près de l'humanité qui travaille. Au lieu de le laisser muser et perdre beaucoup de sa puissance d'évocation à créer le mythe, sachons intéresser l'enfant au travail humain, allons visiter avec lui un atelier de menuiserie, ou une forge, racontons-lui tout le travail qu'a coûté le morceau de pain dans lequel il mord de si bon coeur, parlons-lui de l'énergie qu'il faut à l'ouvrier pour accomplir courageusement sa journée de rude labeur, et surtout enseignons-lui à respecter le travailleur qui nous fournit tout ce dont nous avons continuellement besoin. Du reste la sympathie de l'enfant va souvent d'elle-même au travailleur. Il me souvient du mot d'un enfant de sept ans environ. Il revenait d'une promenade causant avec une grande amie. Tout-à-coup il s'arrête, et montrant à quelque distance un vieux cantonnier qui cassait des pierres au bord de la route: «Attends-moi un moment, dit-il, je veux aller dire bonjour à ce cantonnier parce qu'il est mon ami». Il courut à lui et lui parla un moment avec animation. Puis, revenant vers sa compagne: «Ne trouves-tu pas, dit-il, que mon ami fait un métier bien intéressant? Quand je serai grand, je voudrais aussi apprendre à casser des pierres… et, tu sais… je lui ai dit mon secret». Le secret du petit garçon c'est que son père était tombé à la Marne, et qu'il ne fallait pas en parler à maman, pour ne pas la faire pleurer. Les éducateurs devront donc s'occuper de l'enfant qui s'ennuie; ils attacheront d'emblée de l'importance aux premiers symptômes de cette passion de l'invention. Il ne se lasseront pas de ramener l'enfant à la réalité, riant avec lui peut-être, de ses fantaisies, mais lui démontrant sur-le-champ qu'il n'y a là qu'un conte de fées. Il faut que l'enfant arrive à reconnaître lui-même que ce qu'il raconte est fictif. Cette tâche est parfois plus difficile qu'il ne le semblerait de prime abord… La manie de raconter comme vraies des petites histoires inventées ne doit pas entraîner pour l'enfant des punitions sévères ou des châtiments corporels. On risquerait ainsi, de le pousser non pas à n'en plus inventer, mais à ne plus les raconter. En élaborant ces mythes, l'enfant ne se sent pas coupable, pas plus que lorsqu'il rêve, et la punition, qui ne guérira pas sa fantaisie, peut léser son sens de la justice, et porter atteinte à la confiance implicite et affectueuse qu'il a en ses parents et qui est le fondement même de toute éducation. L'important et de replacer continuellement l'enfant en pleine réalité et de s'ingénier à lui rendre cette réalité intéressante. On ne détruit que ce qu'on remplace, cette maxime est aussi vraie en matière d'éducation, qu'en tout autre domaine. La tâche n'est pas facile, mais il faut arriver à détacher l'enfant de ce qui n'est qu'illusion, et à lui faire trouver plus d'attrait à la réalité qu'au mensonge. (1) Fragments d'une conférence donnée à l'Institut J.J. Rousseau par Mlle H. Malan, en février 1924. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |