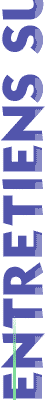
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURPourquoi ces conflits entre parents et adolescents ? Le Professeur Osterrieth, de Bruxelles, abordait ce sujet au cours d'un exposé fait devant les membres de la Commission de l'adolescence instituée en vue de l'Année mondiale de la Santé. Dans Le Ligueur (mars 1960), nous en lisions un bref compte-rendu : Argent, sexualité, religion… Trois problèmes primordiaux… que les parents semblent craindre d'aborder avec leurs grands enfants. J'ajoute, et ceci est très important, dit le conférencier, que les adolescents avec lesquels je suis en contact, sont ceux qui ont des problèmes. Mes remarques ne s'appliquent donc pas nécessairement à la généralité. Chaque fois que je me trouve devant un « adolescent en difficulté », je retrouve cette même carence de contact avec les parents. Le père d'un gars de seize ans me demandait dernièrement ce qu'il devait lui donner d'argent de poche. « Cet argent est-il destiné aux menus plaisirs ou s'agit-il d'une somme que votre fils doit gérer lui-même ? Doit-il faire les achats indispensables ? Vêtements, cahiers, cartes de tram ? Pourquoi ne lui demanderiez-vous pas de présenter un budget et d'exposer ses besoins? » Ce monsieur a sursauté d'épouvante; il fut profondément choqué quand j'ajoutai en plaisantant :« Naturellement, s'il vous demande un dixième de vos revenus mensuels, vous lui démontrerez que c'est impossible ». Evidemment, nous avons l'impression que notre statut est en cause, quand on nous demande quel est notre revenu. Cet exemple me semble significatif. Jamais on n'a discuté avec ces jeunes des grandes questions vitales : sens de la vie, politique, budget, etc… Le « charmant petit » devient l'insupportable grand. Et pourquoi ? Quand vers trois, quatre ans, l'enfant a commencé de s'habiller tout seul, de faire des commissions, on a été ravi. Mais quand, vers quatorze, quinze ans, il a fait preuve d'initiative et a montré qu'il pouvait faire quelque chose sans tenir la main de ses parents, ces derniers se sont sentis en quelque sorte ulcérés :« Quel culot ! On n'a plus rien à dire ici ! ». Ils se sont sentis menacés dans leur autorité, ils ont fait une réaction de menace : ils ont « serré la vis ». Cette réaction est d'ailleurs assez courante. Pour le tout petit, nous sommes des espèces de divinités, auréolées de pouvoirs quasi absolus. Notre prestige n'est pas en cause, et nous nous montrons assez débonnaires. Vers 9, 10 ans, l'enfant déboulonne la statue ; il attache une importance extrême au « groupe », camarades, amis, classe ; le prestige de l'adulte s'en trouve fort amorti et ce dernier est tenté de réagir par une sévérité accrue. Que font les parents éclairés? Quand l'enfant approche de ses 8, 9 ans, ils adopent graduellement une attitude proche de celle du groupe. Ils passent du « paternalisme » à la « libre discussion », ils abandonnent le rôle de « divinité » et introduisent dans la vie familiale une attitude nouvelle, démocratique en quelque sorte : discipline librement consentie, éclairée, expliquée. Apparemment, réduction de l'autorité : en réalité, rapprochement des jeunes et des parents, autorité réelle. (Entendons-nous : je dis attitude démocratique, mais non démagogique : les parents s'expliquent avec les enfants sur un pied d'égalité, font des concessions; ils ne démissionnent pas!) Dangers de l'attitude dictatoriale. L'enfant, en général, la supporte assez bien, tant qu'il est tout petit, mais à partir de 8, 9 ans, il la tolère fort mal. Que peut-il arriver? Qu'il plie, qu'il abdique. En ce cas, l'enfant perd dynamisme et initiative. Il restera soumis à des consignes qui le dépassent; mais plus tard, ne se considérera jamais comme un adulte, n'agira jamais en adulte. Il se peut aussi qu'au contraire, l'enfant se révolte, devienne difficile, prenne le contre-pied de tout ce qu'on veut lui faire faire. Cette attitude est plus positive que la première, mais n'est pas idéale non plus ! Nous souhaitons que nos enfants soient des personnes sachant vivre avec autrui, et non des gens frustrés ! La troisième attitude est la plus fréquente : les jeunes disent : « Les vieux déraillent. Ils ne comprennent plus rien à rien. On était bons amis, mais ils deviennent embêtants ». Et ils se détournent de leurs parents, continuent leur chemin, creusant un fossé entre eux et les leurs. Cela, au moment où ils ont justement le plus grand besoin de l'autorité parentale, le plus grand besoin d'avoir confiance en quelqu'un. « Quand mon père commence, me disait un jeune, je sais qu'il en a pour un quart d'heure et alors, je pense à autre chose! » La crise n'est pas fatale ! Si dès les premiers jours de sa naissance, les parents sont pénétrés de l'idée qu'ils élèvent leur enfant pour qu'il puisse se passer d'eux, qu'il devienne autonome et libre, ils n'auront aucune réaction d'angoisse devant ses velléités d'indépendance. Le prestige adulte ne sera pas un obstacle à l'entente entre parents et jeunes et il deviendra inutile d'avoir recours à l'autorité punitive pour sauvegarder l'autorité réelle. Un climat de vérité. Devons-nous vivre deux vies? L'une devant nos adolescents, l'autre strictement pour nous ? Devons-nous éviter toute discussion sur les sujets qui engagent, comme si nous avions peur de dire : « Tu vois, je me suis trompé »? Non, n'est-ce pas? Cela peut arriver à un adulte de se tromper, et il ne faut pas en rougir. Le jeune doit pouvoir s'appuyer sur l'adulte, trouver en lui un modèle qui ne soit pas effrayant ou inaccessible. Il doit aussi pouvoir s'opposer à l'adulte ; il faut qu'il puisse nous pénétrer un peu, nous saisir par le dedans. Le jeune veut être un adulte, savoir comment raisonner, pourquoi il raisonne ainsi… Nous ne serons plus des divinités pour les jeunes, mais nous pouvons encore être des gens auxquels on a envie de ressembler. J'ai revu bien des familles qui étaient venues à nous pendant un moment de difficulté ; beaucoup nous disent :« Un conseil qui nous a bien aidés, c'est celui de ne pas être trop sensibles à notre prestige et de traiter les enfants avec considération ». Je songe à ce foyer, qui semblait un Snack Bar, où l'on ne venait que pour manger et dormir, où la tension entre parents et enfants était extrême. Les parents ont eu le courage d'accepter qu'on discute leur position. Ils ont dit aux enfants :« Cela ne va pas. Que proposez-vous ?». Les jeunes ont donné leurs avis ; de bons et de saugrenus. Les adultes aussi. On a discuté. Cela a considérablement allégé le climat familial et les jeunes se sont sentis des responsabilités. N'oublions pas que l'autorité des parents doit s'accomplir en fonction de l'âge. L'éducation, c'est une émancipation progressive. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |