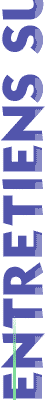
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURLe rôle du père. Les insuffisances d'autorité paternelle* L'autorité est la fonction primordiale du père, comme l'amour est celle de la mère. La carence de l'un ou de l'autre entraîne des conséquences plus graves que l'excès parce que ce dernier, tout en dépassant le but, reste néanmoins dans le sens de cette fonction. Un père faible sera plus nuisible qu'une mère faible. Un manque d'amour sera par contre moins nuisible s'il est le fait du père plutôt que celui de la mère. La faiblesse d'un père a presque toujours pour origine son absence du foyer, que cette absence soit réelle ou virtuelle. L'absence réelle Lorsqu'elle est durable, elle a le plus souvent pour cause la mort, l'emprisonnement, l'éloignement prolongé du fait de la maladie (tuberculeux en sanatorium, aliéné interné). L'hérédité ou l'exemple antérieur partagent alors parfois avec l'absence d'autorité la responsabilité des conséquences de cette situation. Les difficultés matérielles qu'entraîne la disparition du chef de famille ne sont pas les moindres et elles auront, à leur tour, de graves répercussions sur le plan psychologique. Sur ce plan, le principe d'autorité n'étant plus offert à l'enfant par son support normal, c'est la mère qui devra l'assumer, alors que ce rôle n'est pour elle que secondaire. Mais surtout, la disparition du père ne permettra pas les fixations nécessaires successives : le garçon restera attaché à sa mère et risquera de manquer sa virilisation : l'image du père absent ne saurait remplacer un être de chair et de sang. Entre un beau-père qu'il détestait, et une mère plus occupée de son mari que de son fils, Baudelaire reconnaît même « qu'il lui manqua peut-être les coups de fouet qu'on distribue aux enfants et aux esclaves » (lettre à sa mère du 21 juin 1861). La fixation initiale de la fille à son père ne pourra plus se faire. Plus tard la grande fille doit s'identifier à sa mère et voir en elle la femme, l'épouse, mère des enfants de l'homme qu'elle aime et non plus seulement sa maman. L'absence du père rend la chose bien difficile. La carence d'autorité entraîne le plus souvent une mauvaise adaptation sociale qui se manifestera soit par l'incapacité de fonder un foyer valable, et surtout de le maintenir, soit par toute la gamme de la délinquance juvénile, puis adulte. Certains pères ne sont absents que par intermittence du fait de leur métier qui les éloigne de leur foyer pour des périodes de plus ou moins longue durée : voyageurs de commerce, marins, par exemple. Le retour périodique permet souvent de régler les conflits importants et les difficultés majeures, et de donner des directives pour la durée de la prochaine absence. Le caractère insolite et un peu solennel de cette façon de faire renforce le prestige du père et son influence, même lors de ses absences. Mais on devine facilement que la mère risque de prendre en charge le rôle du père, sans pouvoir totalement réussir une tâche qui n'est pas la sienne. D'où ces conflits d'autorité inévitables aux retours du père, conflits doublement nocifs, parce qu'ils détruisent l'apparence d'autorité que la mère avait pu édifier, et parce que l'enfant, devant les avis contradictoires de ses parents, perd toute confiance en leur autorité et tire son épingle du jeu. Par ailleurs, si l'absence du père est suffisamment prolongée, le garçon ne rencontrant aucun rival dans la possession de sa mère (« ma maman à moi tout seul ») considérera comme une trahison de sa part l'affection qu'elle pourra manifester à son mari, lors de ses retours. Son père sera pour lui un intrus. L'absence virtuelle Le père qui travaille trop rentre généralement au foyer harassé et souvent irritable, bousculant ses enfants pour avoir la paix. Dans d'autres cas, au contraire, et pour avoir la paix encore, il accepte toutes les capitulations, commet toutes les petites lâchetés, refuse d'écouter les doléances justifiées de sa femme concernant le comportement des enfants sous prétexte qu'il ne veut pas passer pour un bourreau. Il veut pouvoir profiter de leur présence pendant les rares heures qu'il peut leur consacrer, renonçant pour cela à son rôle réel au bénéfice d'une satisfaction personnelle et captative. Il les dirige mal et, pour cela même, quoi qu'il en pense, les aime mal. C'est le plus souvent dans les professions libérales que l'on rencontre ce type de père : médecins ou avocats surchargés de clientèle, ingénieurs écrasés de responsabilités, industriels accablés de soucis. La vie rurale qui impose des rythmes de vie plus rationnels, les fonctions administratives et les métiers ouvriers, aux occupations et aux horaires mesurés, risquent moins de provoquer cet absentéisme paternel, si nocif aux enfants. Le père met en général son excès de travail sur le compte de son désir d'améliorer la situation matérielle de la famille, d'assurer son avenir. En réalité, cette pseudo-prévoyance détruit au comptant ce qu'elle prétend gagner à terme. Il y a des pères qui désertent leur foyer au sein même de celui-ci. Volontairement indifférent à tout ce qui peut troubler ses habitudes et contrecarrer ses manies, le père se livre quand il est chez lui aux occupations qui lui plaisent : bricolage, collections, lectures, radio, ne s'intéressant en rien au sort des siens et à leurs problèmes. Il n'est ni trop faible ni trop autoritaire avec ses enfants : il se contente de ne pas être. S'il sent qu'il ne pourra éviter d'être mis en cause ou à contribution, si ses prétextes habituels ne le protègent plus suffisamment, il sort et déserte alors à l'extérieur et s'organise une petite vie de célibataire bien remplie par des occupations qui restent assez semblables malgré les différences sociales : belotte au café ou tournoi de bridge, match de football ou compétition de golf. Ce ne sont jamais, en tout cas, les activités sociales altruistes, syndicales ou politiques, qui attireront ces égoïstes fonciers. Il faut rapprocher du précédent un autre type de père, plus proche du pathologique, celui qui s'est marié sans trop savoir pourquoi et qui s'évade de la réalité dans des préoccupations ou des rêveries que ne parviennent pas à troubler les exigences familiales. Bien que présent en corps au foyer, il en est totalement absent en coeur et en esprit. Certains pères, enfin, animés d'excellentes intentions, se targuent d'être les camarades de leurs enfants, les privant ainsi d'une autorité indispensable à leur bonne évolution affective. On comprend ainsi la raison de certains comportements infantiles apparemment paradoxaux d'hostilité contre un père pourtant « bien gentil», mais en réalité trop faible. Plus il multiplie les témoignages d'affection ou même les capitulations pour gagner l'attachement de son fils, plus celui-ci s'éloigne de lui. Le défaut d'autorité prive les jeunes des freins nécessaires à trois de leurs modalités réactionnelles : opposition, imitation, compensation. La réaction d'opposition est nécessaire, traduisant la tendance à l'émancipation dont l'absence indique une immaturation. Mais elle se satisfait normalement dans des manifestations anodines qui rassurent l'enfant sur son indépendance : retards, fugues brèves qui sont la préfiguration du saut du mur de la caserne. Si le mur familial est abattu par des parents abusivement libéraux, l'enfant recherche souvent un autre obstacle : et c'est l'escalade du mur juridique ; bien des cambriolages n'ont pas d'autres mobiles. La réaction d'imitation se combine à la précédente. Après avoir brisé les idoles familiales, l'enfant se cherche d'autres modèles. Il les emprunte aux lectures, au cinéma, aux camaraderies. Il les élit opposés aux normes de son éducation : le malfaiteur du roman noir, le gangster du film policier, le camarade affranchi des règles morales. La réaction de compensation permet à l'adolescent, par des délits gratuits, d'affirmer son assurance et sa personnalité. Plus redoutables encore que les conséquences immédiates sont les conséquences lointaines de ces carences d'autorité. Dans la personnalité, on ne trouve ni armature, ni ligne de force, le caractère manque de fermeté, de consistance, de résistance et la conduite de la vie est marquée par l'indécision et par l'incertitude, par la nonchalance devant le plaisir ou les engouements capricieux ; la conscience morale est pauvre, sans dynamisme. Les relations du sujet avec le monde sont fortement perturbées par cette inconsistance de la personnalité : risques téméraires, peur de l'action, démission, instabilité, caprices alternant sans ordre, témoignent souvent d'un sentiment d'insécurité et d'anxiété mal conscient. L'égocentrisme foncier peut être masqué par une sensibilité de surface. En fait, on n'est guère étonné de retrouver ici ce qui, pour nous, est le trait fondamental de la carence affective infantile durable : l'incapacité pour le sujet d'établir des relations sociales normales. La famille étant une société en miniature, il est donc souhaitable qu'elle offre à l'enfant les éléments qui lui permettront de mener, plus tard, une vie sociale normale. * Voir numéro de septembre 1968. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |