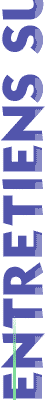
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURL'adoption Pourquoi adopte-t-on un enfant ? Peut-on prévenir ou réduire les risques de l'adoption ? Quel est l'âge le plus favorable ? Que penser de l'hérédité ? Faut-il révéler à l'enfant sa condition d'adopté ? Pour les lecteurs que ce genre de questions intéresse, nous recommandons la lecture d'un ouvrage bien documenté et accessible : « L'adoption, ses données médicales, psychologiques et sociales », par le docteur Clément Launay - Editions sociales françaises, Paris. En voici quelques extraits : Introduction Il y a de bonnes et de mauvaises adoptions ; les conditions non pas tant matérielles qu'affectives des adoptants et de l'adopté font, en réalité, que leur sort commun sera bon, médiocre, ou même mauvais, de même que le mariage, acte juridique ou à la fois juridique et religieux, peut être, suivant la forme de pensée des deux conjoints, suivant leur entente préalable et leur amour mutuel, un bon, ou un médiocre, ou un mauvais mariage. Ces conditions affectives, on les recherche surtout chez l'enfant adopté, dont on pense inévitablement qu'il est la pierre d'achoppement. Ne serait-on pas en droit de suspecter chez lui tout ce que sa mystérieuse ascendance lui aurait apporté ? C'est cet aspect de sa mentalité (les tendances innées) qui est en général seul considéré. Mais il y a des cas cependant, lorsqu'il s'agit d'un enfant qui a été adopté après ses premières années, où entre en ligne de compte son passé mental avant l'adoption : les premières années comptent plus qu'on ne croit dans le développement ultérieur du caractère. S'est-on aussi préoccupé de favoriser au mieux la transplantation de l'enfant de sa famille nourricière dans sa famille adoptive ?… On adopte pour rendre heureux un enfant voué à un sort hasardeux. Cela va de soi, semble-t-il. Encore faut-il qu'on y ait pensé, qu'on se soit même interrogé sur ses intentions, qu'on en ait parlé pour bien comprendre ce que l'on pense. Les vues strictement personnelles (crainte de vieillir seul, besoin mystique de protéger, de guider, de réaliser dans l'enfant ses propres désirs, etc.) s'imbriquent parfois si étroitement avec les mobiles généreux proclamés, elles se dissimulent si facilement derrière eux, aux yeux même de la personne qui est en jeu, qu'il apparaît nécessaire de solliciter des adoptants éventuels un travail de réflexion préalable. Effectivement, il va falloir, toute l'enfance durant, concilier deux nécessités : éduquer l'enfant tel qu'il est, et non pas tel qu'on l'aurait voulu ; réaliser au mieux une vraie famille, où chacun ait heureusement sa place. Eduquer l'enfant tel qu'il est c'est, dira-t-on, le problème de tous les parents ; il est facile ou difficile à résoudre, d'autant plus facile que ces derniers ont une attitude éducative plus souple, moins rigide. En fait, ces vertus sont plus nécessaires encore chez les parents adoptifs que chez les parents naturels : car il est parfois plus douloureux pour eux de s'apercevoir à la longue que, par exemple, leur enfant n'est pas doué comme ils l'auraient souhaité. Il est parfois difficile de dire à un enfant qu'il est adopté, et pourtant si l'on veut l'élever «tel qu'il est», on ne peut lui cacher sa véritable naissance, sinon toute l'éducation s'en trouvera faussée, et cela d'autant plus que le temps aura passé… Tout le problème de l'adoption est là : adopter, ce n'est pas prendre avec soi un enfant parce qu'on en a besoin, mais ce n'est pas non plus ouvrir son cÅ“ur à n'importe quel enfant, dans n'importe quelles circonstances. Entre l'adoption intéressée d'autrefois et une conception totalement généreuse, voire mystique, de l'adoption, doit se situer l'attitude adoptante habituelle, celle qui conduit aux familles adoptives stables et équilibrées. Nul n'empêchera qu'il n'y ait, dans toute adoption, un risque, des aléas. N'y a-t-il pas aussi un risque à avoir soi-même des enfants ? Et la vocation des parents, que postule toute adoption, que tout adoptant s'engage implicitement à avoir, du seul fait qu'il adopte, implique aussi que l'adoptant accepte ce risque : inévitable contrepartie de la vie féconde et enrichissante dans laquelle, en adoptant, il lui convient d'entrer. La révélation de sa condition d'adopté La conduite naturelle, celle que conseillent tous les organismes s'occupant d'adoption et que nous avons vu mettre en oeuvre maintes fois sans aucune difficulté, est de dire la vérité à l'enfant et de la dire le plus tôt possible. Il n'y a pas lieu de choisir un certain jour et un certain âge pour prononcer des paroles qui prendraient alors un caractère inutilement solennel, mais bien d'élever l'enfant dans sa condition d'adopté. Dès qu'il est en âge de comprendre, il sait que sa mère est morte ou disparue, et qu'il est venu à l'âge de quelques mois dans cette deuxième famille, qui est la sienne, auprès de cette deuxième mère qui est sa mère d'adoption, mais identique pour lui à une vraie mère. La clientèle de pédiatrie, qui conduit à suivre très longtemps et à connaître de près bien des familles, met parfois le médecin en présence de cas semblables ; j'en pourrais citer sept ou huit, où cette manière d'agir a été appliquée à la satisfaction de tous. Exemple : Mlle G…, célibataire, a adopté six enfants. Les deux aînés, Bruno et Marc, ont actuellement 16 ans. Elle a pris pour principe de ne jamais mentir aux enfants, mais d'attendre qu'ils s'intéressent au problème de la naissance pour les renseigner sur leur propre situation. C'est vers l'âge de 6 ans que Bruno et Marc ont posé des questions sur le mariage et la naissance des enfants : - Comment as-tu des enfants, puisque tu n'as pas de mari ? - Je t'ai trouvé bien au chaud dans un berceau. - Dans un berceau, où ? - Dans une maison comme celle que nous avons vue à B. (il s'agissait d'une pouponnière). Alors Bruno, très ému, s'approche de Mlle G. avec angoisse : - Mais, quand tu es venue me prendre, il y avait d'autres enfants dans les berceaux ? - Oui, beaucoup d'autres. Alors, d'une voix effrayée comme quelqu'un qui l'a échappé belle, il dit, en la serrant dans ses bras :« Oh maman, je t'aime beaucoup parce que c'est moi que tu as choisi ; heureusement que tu n'as pas pris un autre. » Puis, ayant réfléchi un instant, il ajoute : - C'est bien mieux comme ça : les autres parents, ils sont obligés d'avoir les enfants qu'ils reçoivent, mais toi tu m'as choisi. La réaction de Marc est analogue à celle de Bruno : inévitablement, comme tous les enfants adoptés, les deux enfants s'inquiètent de leur vraie mère : - Pourquoi ma vraie mère m'a-t-elle abandonné ? Mlle G., là aussi, répond la vérité : dans la pouponnière, chaque bébé avait été apporté par sa mère ; telle était morte, telle autre, devant travailler pour vivre, n'avait pu emmener son enfant ou avait eu peur de ne pouvoir subvenir à ses besoins. Un peu plus tard, à la campagne, voyant des oeufs éclore et des poussins courir, Marc et Bruno sont mis en présence de la double fonction maternelle : mettre au monde et couver; eux ont eu pour cela deux mères successivement première maman, deuxième maman. A ce sujet, Marc, un jour, ayant réfléchi, dit : - « Première maman, deuxième maman », qu'est-ce que c'est que cela ? L'autre ne m'a pas voulu, toi tu m'as voulu, c'est toi qui es une vraie mère. On le voit, loin de faire naître un malaise entre parents et enfant, la connaissance par celui-ci de sa véritable condition provoque chez lui un sentiment de sécurité accru à l'évocation du danger auquel il a échappé, et même de reconnaissance quand il pense qu'il a été « choisi ». En procédant ainsi, on n'a pas véritablement « révélé » à cet enfant de 5 ou 6 ans sa filiation véritable, on la lui présente d'emblée comme toute naturelle ; on l'élève dans sa qualité d'adopté et le climat familial aimant dans lequel il baigne le soustrait à toute inquiétude. Il n'y a jamais de moment précis, émouvant, où on lui « révèle » ce fait essentiel que sa mère n'est pas sa vraie mère. Sans doute ne comprend-il pas pleinement d'abord ce qu'on lui dit, mais c'est précisément cela qui convient ; en lui parlant ainsi, les parents lui permettent de s'informer plus tard ; si plus tard un doute apparaît, une question se pose, il n'hésite pas à les interroger : il n'y aura jamais de fossé entre eux et lui. Cette attitude sincère vis-à-vis de l'enfant, attitude telle que celui-ci sente en toute circonstance qu'il peut poser à ses parents n'importe quelle question sur n'importe quel problème qui l'inquiète, n'est pas particulière à l'adoption. Elle est, à notre sens, une des conditions nécessaires à un climat familial heureux, sans réticence, sans arrièrespensées… Que dire de sa mère à l'enfant ? Question délicate, d'un grand poids chez les adoptants qui hésitent à révéler. Ceux même qui ont dit la vérité à l'enfant, et le sentent heureux, conservent parfois une appréhension ; plus tard, à sa majorité, l'enfant n'ira-t-il pas à la recherche de sa mère naturelle ? Ne s'écartera-t-il pas de ses parents adoptifs ? Dire qu'elle était vivante et qu'elle a abandonné l'enfant, n'est-ce pas donner à celui-ci l'idée qu'il pourrait un jour la retrouver ? Dire à l'enfant que sa mère l'a abandonné, n'est-ce pas jeter le discrédit sur sa mémoire ? A-t-on le droit de forcer la vérité et de dire qu'elle est morte ? Ce serait ainsi supprimer toutes les difficultés, et la mort juridique n'est elle pas une sorte de mort ? Mais cette restriction mentale heurte bien des consciences. Presque tous les adoptants se bornent à dire à l'enfant qu'ils l'ont trouvé dans telle pouponnière ou chez une nourrice, et ne savent rien de plus ; tous estiment que, une fois la chose dite, une fois l'enfant grandi et bien au courant de sa situation, il n'y a plus lieu pour personne d'en reparler ; la mère n'est ni discréditée, ni valorisée, elle a disparu : on ne sait rien d'elle. Il y a certainement plusieurs solutions possibles, et nul ne songe à donner aucune règle à ce sujet. Nous croyons que moins on fardera la vérité, mieux cela vaudra et qu'en définitive, si l'enfant a trouvé dans ses adoptants de « vrais parents», le problème de sa mère le préoccupe peu. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |