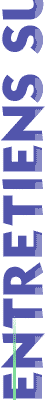
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURLu pour vous Le souffle de la guerre Hermann Woulk - (éd. Robert Laffont) (Best-seller), 2 volumes de 520 et 513 pages, 31,25 F. chacun. Pour ceux qui aiment garder pour leurs vacances un bon roman à la fois instructif et palpitant, voici les deux volumes du «Souffle de la guerre» par l'auteur du fameux «Ouragan sur le Caine». Ce roman, qu'on a cité comme le «Guerre et paix» des temps modernes, nous fait suivre une série de personnages très attachants, pendant la dernière guerre mondiale. Chacun des héros vit la guerre dans d'autres conditions. Ce livre a beaucoup de chances de plaire à des lecteurs très différents : les uns se passionnant plus pour l'aspect romanesque, les autres appréciant surtout le côté documentaire. L. H. La clé sur la porte Marie Cardinal - (éd. Grasset), 247 pages, 18,25 F. Marie Cardinal a 44 ans, un mari qui travaille dans un autre continent et 3 adolescents qui partagent sa vie parisienne. Elle déplore l'éducation conventionnelle qu'elle a reçue, essentiellement basée sur des règles à observer : on ne croise pas les jambes, on finit ce qu'on a dans son assiette, on ne juge pas ses parents, on se brosse les mains avant chaque repas, on ne critique pas les professeurs. Le contact humain, la chaleur, les échanges dont elle a été privée, elle voudrait que ses enfants les connaissent. Elle voudrait que les amis de ses enfants puissent aussi en bénéficier. C'est pourquoi elle ne ferme plus l'appartement à clé. Qui va passer par cette porte toujours ouverte ? Combien sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? De quoi ont-ils besoin ? Et quel genre de réflexions l'adulte de 40 ans est-elle amenée à faire au cours des expériences tantôt graves, tantôt comiques qui se succèdent ? Les parents d'adolescents, aujourd'hui, ont mille raisons d'être parfois perplexes et désemparés. Ceux qui ont assez de courage pour sortir de l'ornière des vieilles habitudes se délecteront du récit de Marie Cardinal. A condition que, pour eux comme pour elle, la chose la plus importante, ce soit la communication. Dans l'extrait qui va suivre, vous assistez à l'apothéose de cette expérience : le moment où l'appartement, déjà saturé, est envahi par une vingtaine d'Américains. « Mes trois enfants - Grégoire, Charlotte et Dorothée - Cécile et Anne, Sarah, Odile, Francis et Geneviève, Ladkar, Françoise, les Dalton, les frères Jackson, trois métis bien élevés, gais et sans histoire, et quatre ou cinq autres dont je n'ai pas parlé dans ces pages car ils ne font rien d'autre que d'être là. «J'ai vécu au contact de cette bande des mois et des mois, quotidiennement. Ils en entraînaient ou en attiraient d'autres qui ne faisaient que passer. J'ai bien dû en loger une cinquantaine et servir des centaines ou des milliers de repas. Je ne sais pas, car pour la tambouille ils se débrouillent tout seuls, ils font la vaisselle et nettoient la cuisine. Côté nourriture mon rôle consiste à remplir de victuailles les placards et le frigidaire au gré de mes possibilités financières. « Quand je peux je fais une grande blanquette, ou un énorme ragoût, ou Lakdar fait un couscous. Nous prenons alors notre repas tous ensemble, empilés tant bien que mal autour de la table trop petite. C'est une fête. Ça se passe en général le dimanche, le seul jour où j'ai le temps de faire de la cuisine. « Ça allait. Nous avions trouvé un rythme, des communications. Ils évoluaient, ils prenaient confiance, ils trouvaient du travail. Et puis un raz de marée est passé sur la maison et je me demande aujourd'hui comment nous en sommes sortis, comment les murs sont encore debout. « C'est venu un soir remorqué par Grégoire : une horde de jeunes pour la plupart étrangers. Des Américains surtout. Une vingtaine. Une nuit, au plus gros de la tourmente, j'ai compté que nous étions 35 là-dedans. « L'incendie de Montréal, la mort de ma mère, les pires crises de Charlotte ou de Grégoire, tout cela n'est rien en comparaison de la seule présence des «Amerloques». « Moi qui croyais être allée au bout de la dépossession je me suis rendu compte que j'étais loin du compte. Plus de chambre, plus de lit, plus de vêtements, plus de jour, plus de nuit, plus rien. Il y avait là Burt, Vic, Megumi, Nina, Frida, Oliver, Frédérique, Michel, Thuan, Philip, Emily, Sher, Leeroy, etc. « La musique sans arrêt, la drogue, l'alcool, les «Jesus freaks», les végétariens, les zen. De drôles d'odeurs habitaient la maison, mélange d'encens, de nuos-mâm, de hach et de patchouli. Les quelques meubles croulaient sous des amoncellements de vêtements super-fricky : chasubles taillées dans des drapeaux, bottes de cow-boys, robes 1925 achetées aux puces, chemises de nuit 1900, chapeaux genre mousquetaire ou Texas, plumes d'autruche, paillettes pour les paupières, paillettes pour les narines, bracelets, colliers, foulards indiens. « J'ai d'abord cru qu'ils ne resteraient qu'une nuit. Mais le lendemain ils étaient là et le surlendemain aussi, trois semaines plus tard ils étaient toujours là. « Tout se désagrégeait, tout se décomposait à leur contact. La crasse, la gentillesse et le néant régnaient. Ils étaient en route pour une croisade sans but. Ils s'arrêtaient par-ci par-là de par le monde, récoltaient un copain, en perdaient un autre. Ils étaient capables de dormir n'importe où et à n'importe quel moment. Ils ne se dérangeaient nullement les uns les autres. « Charlotte manquait de plus en plus le lycée. Grégoire s'était trouvé deux petites Américaines. Seule Dorothée, toujours impeccable, trouvait le moyen de faire ses devoirs et d'être à l'heure le matin pour ses cours. Telle la statue du commandeur elle enjambait dignement les corps endormis, laissant derrière elle un parfum de lavande et de propre qui devenait le seul élément baroque de cette assemblée. Je croisais souvent son regard courroucé, mais je n'y répondais pas. Je ne savais pas. Je voulais connaître, comprendre. J'ai cru pendant longtemps qu'ils avaient une philosophie, une pensée, un ressort. Ils n'en avaient pas ». M. L. Pas d'autre langage qu'un cri Richard d'Ambrosio - (éd. Fleurus 1971), 280 pages, 20 F. Une enfant de 12 ans, au passé si terrifiant qui l'a rendue muette, est sauvée par un médecin analyste exceptionnellement humain, mais aussi et surtout par l'amour des religieuses d'un orphelinat, femmes d'un dévouement infini, auxquelles l'auteur, qui est l'analyste lui-même, rend gloire tout au long de l'ouvrage. L'histoire est authentique. La fillette avait été retirée à ses parents, pauvres êtres alcooliques et inadaptés ou, vus sous un autre angle, horribles monstres, qui avaient voulu la faire frire - oui frire - dans une poêle quand elle avait un an… Après des années d'hôpital, confiée finalement à l'orphelinat tenu par ces femmes extraordinaires - de vraies mères - elle a 12 ans quand l'analyste la prend, gratuitement, en charge. Jusque-là personne ne lui a entendu dire un seul mot. Il faudra à l'analyste deux ans de monologue devant elle pour lui arracher enfin le premier mot, qui jaillira dans un cri. Le livre n'est pas du tout le rapport d'une psychanalyse, mais l'histoire, bouleversante, de ce que peuvent des êtres vraiment capables d'aimer pour sauver un enfant. En résumé, il est la preuve que la technique est indispensable, mais que sans la tendresse elle ne pourrait pas grand'chose. Rien peut-être. Cet ouvrage, très riche, mais simple et plein d'un humour chaleureux, se lit comme un très beau roman. N. D. Le tourniquet des innocents Roger Ikor - (éd. Albin Michel), 316 pages, 24 F. « Roman de la jeunesse en quête de sa raison de vivre », nous dit le texte de présentation. Mais aussi conflit des générations et drame domestique de la famille d'un professeur d'université. Roger Ikor n'écrit pas pour ou contre les jeunes, pour ou contre les adultes; il essaie de sympathiser au désarroi pénible des parents, et de comprendre l'angoisse des adolescents. A. J. La vie quotidienne des premiers chrétiens R.P. A. Hamman - (éd. Hachette), 200 pages, 22 F. Ce livre traite d'une époque bien reculée : l'aube du christianisme. Il évoque la grande aventure de la diffusion de l'évangile après la disparition des apôtres de Jésus. Au gré de pages faciles à lire, c'est toute la vie chrétienne qui s'y trouve décrite. Chaque chrétien était tenu de rompre ses attaches avec le milieu païen, il lui fallait inaugurer un style de vie original et difficile. « Les premiers grincements, les premiers heurts apparaissent dans les relations de chaque jour, où le paganisme pénètre la trame de la vie familiale, professionnelle et civique, où l'homme tout entier appartient à la cité, avec ses biens, sa pensée et même sa conscience… L'épreuve commence dès le foyer. La conversion d'un membre de la famille pose des cas de conscience et peut tourner au drame. Le Chrétien, jusque dans son intérieur, est prisonnier des divinités païennes : elles le guettent, le cernent, depuis le seuil où brûle une lampe, jusqu'aux montants des portes où fleurissent les lauriers. Comment les tolérer, comment ne pas composer ? ». Ce court extrait situe bien le problème de la vie quotidienne de ces premiers chrétiens, qui furent souvent des martyrs. M. L.-W. Le Barbare Henri-François Rey (éd. Robert Laffont 1972), 219 pages, 19,50 F. L'histoire : « Un père de 50 ans voit arriver un jour chez lui un garçon de 15 ans, son fils, parfait inconnu sorti de son passé ». L'adolescent exige provocativement que son père devienne un être libre. Lui-même, l'adolescent, lutte sans s'en rendre compte pour arriver à s'intégrer à la vie et parvenir à s'y attacher. Certains aspects sont peut-être contestables, mais non les thèmes, et si l'ouvrage est «contestataire» c'est dans le meilleur sens : l'exigence d'une attitude vraie - c'est-à-dire en conformité avec ce que l'on pense et ce que l'on est - et la recherche de la vraie liberté. Au fin fond, aussi, le désir éperdu de ne pas détruire d'avance les chances d'une communication qui pourrait exister. L'intérêt du livre me semble résider dans les discussions qu'il ne manquera pas de susciter. Elles pourront être passionnées, voire violentes, mais nul doute qu'elles ne soient fructueuses, car dans la mesure exacte où les jeunes et leurs éducateurs seront forcés de se dé-masquer pour discuter l'ouvrage, dans cette même mesure pourra se créer - ou se recréer - la possibilité du dialogue entre eux. Ce qui n'est pas peu de chose. N. D. L'Attrape-coeur J.-D. Salinger, roman traduit de l'américain par Jean-Pierre Rossi. (éd. Le Livre de poche), 384 pages Livre à déconseiller aux personnes qui ne jurent que par Littré et Grévisse. Il s'agit en effet d'une traduction de l'américain. Or c'est un jeune homme de 16 ans qui parle, et il parle comme les jeunes de son pays, soit en utilisant une espèce d'argot, ou plutôt un langage à la syntaxe simplifiée, au vocabulaire restreint où les mêmes expressions au sens plus ou moins précis reviennent constamment. Comme il ne se fait pas faute d'employer des termes grossiers ou même orduriers et qu'en outre la traduction n'est pas parfaite, il faut faire un sérieux effort pour se mettre au diapason. Mais une fois cet effort fait on est amplement récompensé. On suit pour ainsi dire pas à pas la vie d'un adolescent avec sa manière de réagir, sa façon de se vanter et de se faire valoir, puis de se juger soi-même avec lucidité, sa volonté de refuser toutes les valeurs conventionnelles et l'impossibilité où il est de s'en passer, son désir de s'affirmer auprès des femmes en même temps que sa peur de s'approcher d'elles, son immense besoin d'affection qu'il n'arrive pas à satisfaire. Toutes ces contradictions apparaissent au cours du récit et donnent une image merveilleusement juste et nuancée de l'adolescent tel qu'il existe, non seulement en Amérique, mais dans tous nos pays continentaux, victimes, comme l'on sait, de la civilisation de consommation… Voici un exemple des réflexions du narrateur sur la religion : « A la fin, pourtant, je me déshabillai et me mis au lit. Il me prit envie de prier ou je ne sais quoi une fois au lit, mais je ne pus le faire. Je n'arrive pas toujours à prier quand j'en ai envie. D'abord je suis comme qui dirait athée. J'aime Jésus et tout, mais je me moque pas mal de la plupart des autres machins, dans la Bible. Prenez les Disciples par exemple. Ils m'ennuient à mourir, si vous voulez savoir la vérité. Ils ont été au poil après la mort de Jésus et tout, mais de son vivant ils lui ont été aussi utiles qu'une paire de chaussettes à un cul-de-jatte. Tout ce qu'ils ont fait c'est de le laisser tomber. Je préfère à peu près tout le monde aux disciples, dans la Bible. Si vous voulez savoir la vérité, le type que j'aime le mieux, dans la Bible, après Jésus, c'est ce lunatique et tout qui vivait dans les tombes et se coupait avec des pierres. Je l'aime dix fois plus que les Disciples, ce pauvre salaud ». |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |