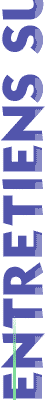
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURElle et Lui commentent un film d'Agnès Varda Lui. - J'ai été voir récemment un film qui vous aurait sans doute plu, étant donné votre féminisme intransigeant. Elle. - Peut-être, bien que je ne sois pas intransigeante. Lui. - Il s'appelle «L'une chantait, l'autre pas», d'Agnès Varda. C'est un film techniquement et artistiquement remarquable mais dont la conclusion m'a laissé rêveur… Elle. - Pourquoi cela? Lui. - Il s'agit de l'histoire de deux femmes. La première, celle qui ne chante pas, a eu deux enfants d'un homme avec qui on ne sait si elle est mariée ou non, qui paraît assez falot et qui, se sentant incapable de gagner la vie de sa famille, ne tarde pas à se suicider. Sa femme, qui a recouru à un avortement pour se débarrasser d'une troisième grossesse, fait courageusement face à la situation, travaille pour élever ses deux enfants et devient finalement secrétaire d'un office de planning familial. Elle. - Il me semble que c'est une histoire très morale qui doit plaire à n'importe quelle femme, qu'elle soit féministe ou non. Lui. - La seconde héroïne est une jeune fille très débrouillarde, en révolte contre ses parents selon la formule à la mode aujourd'hui. C'est elle qui procure à son amie l'argent nécessaire à l'avortement. Elle se lance ensuite dans une carrière de chanteuse. Après beaucoup d'aventures, elle tombe amoureuse d'un Iranien qui l'emmène dans son pays où elle vit un conte des mille et une nuits. Séduite par tant de splendeurs, elle se marie et ne tarde pas à avoir un enfant. Elle. - Mais c'est aussi une histoire morale! Lui. - Oui, mais après avoir goûté aux délices de l'Orient, elle éprouve le besoin de rentrer en France et, lorsqu'elle y est, refuse net de retourner en Iran comme le lui demande son mari qui fait alors valoir ses qualités de père et de chef de famille. Comment résoudre ce conflit en tenant compte des intérêts et des sentiments du mari, de la femme et de l'enfant? Elle. - On peut imaginer plusieurs solutions dont aucune ne me paraît satisfaisante. Lui. - On voit, ma chère, que vous n'avez pas l'imagination fertile d'une véritable féministe. L'héroïne d'Agnès Varda qui avait, des années durant, vécu au mépris des conventions bourgeoises et en rejetant l'institution surannée de la famille, se trouve une vocation maternelle et fait à son mari la proposition suivante: «Tu peux rentrer dans ton pays avec ton fils, mais auparavant tu me fais un second enfant, ainsi nous aurons chacun notre part.» Ainsi fut fait et l'on nous montre de très belles images de la mère magnifiquement épanouie, allaitant, caressant, dorlotant son bébé et visiblement au comble du bonheur. Elle. - Votre histoire continue à être parfaitement morale puisqu'elle montre que la seconde héroïne, après avoir beaucoup chanté, arrive à découvrir l'amour maternel et à se réaliser en tant que femme. Un tel film ne peut que renforcer mon féminisme. Lui. - C'est bien ce que je crains, car je ne crois pas qu'un tel féminisme soit défendable. Songez un peu au rôle qui est fait à l'homme dans ces deux histoires. La première héroïne, celle qui ne chante pas, a refusé de se marier sans doute pour ne pas céder à un préjugé bourgeois. L'homme n'a joué que le rôle d'amant. Il s'est montré incapable de remplir son devoir de père et a disparu après avoir accompli son devoir de reproducteur. Il semble bien n'avoir joué aucun rôle dans la vie de cette femme qui ne trouve son équilibre qu'une fois seule avec ses enfants qui sont toute sa raison d'être. Elle ne consent à se marier que plus tard lorsque ses enfants sont élevés et qu'elle a peut-être peur de la solitude. Quant à l'autre héroïne, celle qui chantait, son attitude donne encore plus à réfléchir. Après avoir «vécu sa vie» comme on dit, et abondamment utilisé les hommes pour son plaisir, elle découvre les joies de la maternité, elle renonce avec allégresse à son mari et à son premier enfant pourvu qu'elle puisse réaliser sa vocation de femme, c'est-à-dire de mère, après avoir écarté de son chemin un mari devenu inutile. Elle. - Il me semble que vous êtes bien sévère pour ces deux femmes qui, après tout, se sont trouvées dans des situations difficiles et qui ont montré qu'elles étaient capables d'y faire face. Je ne vois pas pourquoi leur attitude me ferait abandonner mes convictions féministes. Lui. - Votre réaction me confirme dans l'idée que ce film est insidieusement dangereux. Il tend à donner du féminisme une idée flatteuse mais fausse qui consiste à faire croire que la seule vocation de la femme est la maternité et qu'il est normal pour elle de considérer l'homme, d'une part comme l'instrument de son plaisir et d'autre part comme le mâle dont on ne peut se passer pour faire des enfants, mais dont c'est au fond la seule fonction. Le mariage est une institution, peut-être critiquable, mais il a au moins cet avantage que la femme qui se marie choisira un homme dont elle sait qu'il sera le père de ses enfants. Par conséquent, il aura un rôle et un rôle important à jouer tout au long de leur vie comme compagnon et comme père. Elle. - Bien entendu, mais jamais les féministes n'ont été adversaires du mariage. Lui. - C'est vrai pour la majorité des femmes, mais un certain féminisme tend aujourd'hui à renverser les rôles. Autrefois la femme n'était qu'un objet pour l'homme, celui-ci ne songeait qu'à son propre épanouissement, à sa carrière, etc. Le féminisme d'Agnès Varda consiste à remplacer la femme-objet par l'homme-objet, ce qui ne peut guère être considéré comme un progrès. L'homme a encore un rôle à jouer, soit comme compagnon de sa femme, soit comme père. Vous qui vous occupez d'éducation vous savez que pédagogues et psychologues s'accordent aujourd'hui sur l'importance du père dans l'éducation. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |