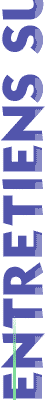
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURA propos des sanctions Jean Piaget a étudié les sanctions utilisées par les parents vis-à-vis de leurs enfants et distingué deux types principaux: Les sanctions expiatoires et les sanctions par réciprocité. Les sanctions expiatoires sont caractérisées par la coercition et une relation arbitraire entre la sanction et l'acte sanctionné. Priver l'enfant de dessert pour avoir déchiré ses livres, ou lui faire copier cent fois «je ne mentirai plus» sont des exemples de sanctions expiatoires. Il n'y a aucune relation« logique» entre déchirer des livres et être privé de dessert. Du fait que, dans les sanctions expiatoires, la relation entre la sanction et l'acte sanctionné est arbitraire, l'enfant ne ressent pas la nécessité de changer son comportement, sinon pour éviter la punition. Pour le dissuader, la douleur de la punition doit être assez forte. Ainsi, lorsqu'une punition n'a pas l'effet désiré, l'adulte tend à rechercher les moyens d'accroître la douleur, créant souvent une escalade de la coercition. Les sanctions par réciprocité d'autre part, sont caractérisées par une coercition minimale et ont une relation «naturelle» ou «logique» avec l'acte sanctionné. Si un enfant déchire un livre, par exemple, l'adulte peut dire: «Nous n'aurons plus de beaux livres si tu les déchires; donc, je ne peux pas te laisser te servir de livres, à moins que tu ne fasses attention. Quand tu seras capable de faire attention, tu pourras t'en servir.» En plus de cette relation logique, les sanctions par réciprocité ont la caractéristique supplémentaire de ne pas exiger de comportements qui apparaissent dès l'abord complètement arbitraires aux yeux de l'enfant. Quand l'adulte dit «Nous n'aurons plus de beaux livres si nous les déchirons», la raison de l'exigence correspond à quelque chose qui est dans les limites de ce que l'enfant peut comprendre. Dans cette situation, il est plus susceptible d'accepter volontiers l'exigence que lorsque nous lui demandons de faire des choses qui n'ont pas du tout de sens pour lui. Bien sûr que l'adulte utilise son pouvoir quand il insiste pour que l'enfant soit soigneux. Néanmoins, il n'utilise qu'une petite part du pouvoir qu'il pourrait déployer. L'enfant, dans cette situation, peut choisir de manipuler les livres soigneusement, parce que l'exigence semble raisonnable. Quand un adulte doit faire preuve d'autorité, il peut le faire de telle manière que l'enfant ait la possibilité d'agir volontairement, construisant par là même ses propres règles morales. Pour illustrer les propos ci-dessus, nous avons choisi de mentionner quelques types de sanctions par réciprocité que Piaget a décrits, mais qu'il n'a en fait pas prescrits. Ce ne sont pas des recettes mais des outils qui peuvent être utiles à l'enseignant et aux parents qui veulent penser à la façon de procéder pour réduire leur pouvoir sans que le chaos règne dans la classe ou à la maison. 1) Exclure l'enfant du groupe social. A l'heure de l'histoire (en classe). l'enfant bruyant dont le bruit couvre l'histoire peut être invité à aller se reposer et se calmer dans le coin de lecture jusqu'à ce qu'il ait envie d'écouter. Les enfants plus âgés pratiquent cette sanction entre eux, par exemple, lorsqu'ils refusent de continuer à jouer avec quelqu'un qui triche. 2) Laisser le méfait engendrer ses conséquences matérielles naturelles ou logiques. Laisser l'enfant vivre avec les conséquences de la destruction d'un objet avec lequel il aimait jouer. Il faut remarquer qu'il n'y a sanction que si l'enfant vit la perte comme quelque chose qu'il regrette. 3) Encourager l'enfant à réparer. Si un enfant détruit un livre, l'adulte peut demander simplement à celui-ci de l'aider à le réparer avec du papier collant. 4) Blâmer l'enfant sans autre punition. Un blâme est souvent suffisant pour que l'enfant comprenne qu'il a rompu le lien de confiance mutuelle et de solidarité en faisant quelque chose qui a déplu aux autres. S'il y a une relation étroite entre l'enfant et quiconque exprime sa désapprobation, cette expression est suffisante pour que l'enfant veuille éviter ce méfait dans l'avenir. N'importe lequel de ces types de sanctions peut aisément dégénérer en une sanction expiatoire si l'adulte a une attitude punitive. L'élément important est l'attitude de coopération entre l'adulte et l'enfant. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |