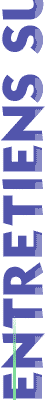
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURLes forts et les faibles * Y a-t-il vraiment, ainsi, deux espèces d'hommes? D'où vient, en dernière analyse, ce contraste si grand entre les forts et les faibles ? Sont-ils réellement si différents les uns des autres ? Telles sont les questions qui se sont présentées à mon esprit ces dernières années et que je veux aborder ici à la lumière de mes observations quotidiennes. Je le fais avec émotion car il y va de deux problèmes capitaux de notre époque. Il y va du problème des nerveux, dont le nombre augmente sans cesse malgré les prodigieux progrès de la psychologie scientifique. En effet, les nerveux se présentent le plus souvent à nous comme des faibles, des écrasés. Ils ont ce sentiment d'appartenir à une autre espèce d'hommes que les forts, qui réussissent dans la vie. Tout médecin peut dire combien il est difficile de rendre à ces vaincus quelque confiance en eux-mêmes. Il faudrait cette confiance pour qu'ils remportent des succès, mais il faudrait des succès pour qu'ils reprennent confiance. Ce qui est plus grave encore, c'est que cette idée d'être voués à l'insuccès déforme leur vision d'eux-mêmes et du monde : ils montent en épingle leurs échecs et les succès des autres, ils dévalorisent leurs propres victoires. Aussi, dans ce livre, je ne m'adresse pas seule ment aux faibles, pour réveiller en eux une espérance. Je m'adresse aussi aux forts, qui sentent tous confusément que ces victoires qu'ils doivent remporter sans cesse, de peur d'être vaincus, entretiennent dans le monde cette atmosphère de violence, cette tension angoissée, cette menace de catastrophe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Or, je crois qu'il y a une grande illusion qui est la cause tout à la fois du désespoir des faibles, du malaise des forts et du malheur de tous. Cette grande illusion, c'est précisément qu'il y ait deux espèces d'hommes, les forts et les faibles. En réalité, les hommes sont beaucoup plus pareils les uns aux autres qu'ils ne le croient. Ce qui diffère, c'est leur masque extérieur, brillant ou déplaisant, c'est leur réaction extérieure, forte ou faible. Mais ces apparences cachent une personnalité intime identique. Sur le terrain de sensibilité innée, vont intervenir les facteurs accidentels d'hypersensibilisation, qui déclencheront alors cette course à l'écrasement que j'ai évoquée. De tous les facteurs accidentels, le plus important me paraît être la mésentente entre les parents. Qu'il s'agisse de scènes et de brutalités quotidiennes ou de ces conflits sourds que trahit un silence de plomb ou de quelque ironie froide et cinglante. J'ai sous les yeux douze observations de ces vies de malheur, toutes remplies de cataclysmes et dont l'enfance s'est déroulée au milieu du drame conjugal des parents. La relation de cause à effet s'impose à l'esprit. « Ma première déception, me dit une malade, date du jour où je me suis aperçue que mes parents ne s'entendaient pas. Cela a été atroce. Je me suis sentie seule et révoltée contre la vie ». D'instinct, l'enfant réclame de ses parents leur unité; aussi s'épuise-t-il en vains efforts pour les rapprocher; il reçoit les coups des d'eux côtés, il souffre à la fois des injures que subit chacun de ses parents; il est écrasé entre le marteau et l'enclume. C'est ce sentiment d'impuissance à réconcilier ses parents qui écrase l'enfant. Il vit dans la terreur d'un nouvel éclat. Il est déjà tremblant quand le père rentre à la maison. Il guette furtivement ses parents, pour supputer leur humeur. Il sait les mensonges que ceux-ci se disent mutuellement, et il redoute que leur découverte soit l'occasion d'une nouvelle scène. Par crainte d'y contribuer lui-même, il devient complice de ces mensonges, bourrelé de remords. Il n'ose s'ouvrir ni à ses parents, ni à ses frères et soeurs, ni à ses grands-parents, de peur d'envenimer les choses. Il garde tout dans son coeur, il se demande avec angoisse comment cela finira, et il en est réduit à pleurer secrètement, la nuit, pendant de longues heures, la tête cachée sous les couvertures. Emporté par la passion du conflit, chacun des parents accuse l'autre devant lui, lui fait des confidences atroces, cherche à lui faire partager ses indignations, lui reproche parfois amèrement de ne pas prendre ouvertement son parti. La dissension des parents aboutit souvent à un tableau que je retrouve dans les antécédents de tant de ces écrasés que je peux l'appeler le schéma classique démission morale du père et domination affective de la mère. Celle-ci, en effet, souffre plus que son mari du conflit conjugal; elle n'a ni le bureau, ni le café pour s'enfuir ; alors elle se console de son vide affectif dans un amour possessif pour son enfant. Le père se désintéresse de cet enfant; il ne s'en occupe plus, parce que celui-ci est devenu la propriété privée de sa femme. Il l'abandonne sans défense à un véritable chantage affectif de la mère, qui le domine par ses exigences ou par ses larmes. Parfois c'est bien plus subtil. Car… «ce qu'on ne dit pas n'en existe pas moins, écrit Benjamin Constant, et tout ce qui est se devine». Sans un mot, par des impondérables, la mère fait sentir à l'enfant qu'il lui fait de la peine, lorsqu'il ne partage pas tous ses sentiments; elle abuse de son coeur pour savourer son attachement; elle y cherche un baume à son malheur conjugal. Elle lui dit qu'elle le laisse libre et il sent bien que ce n'est pas vrai. C'est une tyrannie libérale. Une de mes malades m'a raconté de façon poignante comment sa mère usait d'une arme toute-puissante : la privation du baiser du soir. La tempête et l'insomnie grondaient jusqu'à ce que l'enfant, vaincu, se levât et vînt faire son abdication pour obtenir le baiser. En mettant une étiquette sur quelqu'un, on contribue inévitablement à le rendre conforme à cette étiquette, surtout dans l'âge si sensible à la suggestion qu'est l'enfance. On en fait un menteur en le traitant de menteur, un égoïste en le traitant d'égoïste, un orgueilleux en le traitant d'orgueilleux. Je ne crois plus aux sales caractères, je ne crois qu'au péché, et c'est tout autre chose. Le premier concept tient au formalisme social, le second au réalisme moral. Tout le monde est pécheur, également pécheur, les braves gens honorables et convenables tout autant que ceux qu'ils méprisent, les parents cruels, injustes et orgueilleux, tout autant que l'enfant qu'ils écrasent de cette expression « sale caractère». Sur le terrain vrai du péché, ils lui montreraient que ces faiblesses dont il souffre, tous les autres hommes en souffrent, même s'ils les couvrent, eux, par des réactions fortes. Ce sentiment l'aiderait à reprendre courage et à se corriger; en le traitant de brebis noire, ils lui donnent, au contraire, un sentiment de solitude morale terrible, celui d'être mauvais, tandis que les autres sont bons. Aussi bien, le vrai sens d'une expérience religieuse, ce n'est pas la transformation qu'elle apporte dans notre vie, c'est que nous avons fait à cette occasion la connaissance de Dieu. Et c'est cela qui demeure, même si notre existence reste encore un mélange de divin et d'humain. C'est cela qui nous aide à accepter notre drame humain, ce drame qui résulte, justement, du perpétuel conflit, en nous, entre le divin et l'humain. Certes, c'est dans la mesure où notre expérience a porté des fruits concrets, dans la mesure où notre vie et notre nature ont subi des changements palpables, manifestes, que nous pouvons témoigner de la puissance de Dieu. Mais celle-ci dépasse infiniment ces petits témoignages. Ce qui importe, ce ne sont pas nos expériences, c'est qu'à leur occasion nous aurons éprouvé le pouvoir de la grâce. Cela, on ne l'oublie pas, même si un jour doit venir où certaines faiblesses, certaines tentations, certains péchés, dont on s'était cru définitivement délivré, reparaissent à l'horizon ; même s'il faut poursuivre inlassablement la lutte contre notre nature. Oui, poursuivre la lutte, tenir tête à ces tendances innées aux réactions fortes ou faibles, que nous avons reçues avec la vie, et dont nous ne nous séparerons qu'avec elle. Mais la lutte ne sera plus pareille. La foi, née à l'occasion d'une expérience concrète, lui survivra, même s'il y a rechute. Ce qui aura changé définitivement, c'est le climat de la vie. Si nos tendances innées demeurent, ce seront par contre les cercles vicieux qui se desserreront, ces engrenages que j'ai décrits et par lesquels elles s'aggravaient sans cesse. Alors, si nous découvrons encore en nous, à notre confusion, des réactions naturelles, fortes ou faibles, loin que cela nous décourage, ce sera l'occasion de nouvelles délivrances. * Extraits du livre du Dr P Tournier . «Les forts et les faibles». Edit. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |