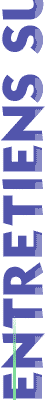
ARCHIVES DE TOUS LES ARTICLES |
| AUTRES MENUS
ACCUEIL ADRESSES • Adresses utiles • Bibliographie • Liens Internet LE JOURNAL |
|
|
|
Les « Entretiens sur l'éducation » est un mensuel publié sans interruption depuis plus de 100 ans.
Le site www.entretiens.ch vous offre la possibilité de consulter en ligne ces extraordinaires archives parcourant/ponctuant au jour le jour l'histoire de l'éducation familiale d'un bout à l'autre du XXème siècle.
La survie de la brochure mensuelle imprimée parallèlement à la distribution virtuelle à travers le site est le garant de la poursuite de cette aventure. La rédaction est assurée de façon bénévole par un groupe de parents passionnés par la réflexion et l'écriture autour du vécu familial. Les frais d'impression du journal et la gestion du site (100 000 pages demandées par mois??)....30.- par an (20€).
En dehors du grand intérêt pour vous de cette matière exceptionnelle, que vous soyez jeune parent, chercheur dans une université ou simplement intéressé par l'évolution des comportements humains, votre soutien par l'intermédiaire d'un abonnement nous est indispensable. Pour les pays lointains et si vous ne désirez pas profiter de la version papier, un abonnement sous forme de pdf est accessible au même prix annuel de CHF 30. Il vous donne un accès complet aux archives
RETOURA propos de l'habitude L'habitude, merveilleux instrument d'adaptation. L'habitude a ce mérite de rendre notre corps très, très savant : on l'appelle d'ailleurs la mémoire du corps. Tout ce que nous avons eu tant de mal à apprendre, à force de répétitions, finit par être connu de nos membres eux-mêmes qui exécutent le travail sans que nous y pensions. Notre main, particulièrement, est fort intelligente elle peut savoir par coeur tant et tant de choses : il suffit qu'un accident nous prive un moment de son usage pour réaliser tous les gestes précieux qu'elle fait dans une journée, sans même que nous nous en rendions compte. Le Créateur a donc mis à notre disposition un corps qui est une merveilleuse machine, capable de fonctionner toute seule, et dont on peut toujours multiplier le pouvoir en essayant d'acquérir de nouvelles habitudes. Bien sûr, il faut d'abord le vouloir; car pour multiplier le pouvoir de la machine, il faut constamment lancer des ordres et se proposer des acquisitions toujours plus nombreuses, la conscience apparaît ainsi comme capable de sculpter notre chair, de la dompter, de la domestiquer… Mais l'habitude peut faire de l'homme un esclave. Nous n'avons cité jusqu'ici que des habitudes dites actives, celles que l'on acquiert volontairement, ou qui demandent des efforts pour s'organiser. Mais il existe aussi des habitudes passives, celles que l'on subit sans le savoir, et qui nous ont été léguées par le milieu, l'ambiance, les influences, les obligations de la vie professionnelle, l'époque… En effet, l'habitude est une force qui agit toute seule, comme l'instinct - n'est-ce pas une « seconde nature » ? - sans nous avertir de sa présence ; elle peut aussi insensiblement envahir notre conscience, au point d'endormir sa vitalité, de tuer sa « jeune liberté ». Et notre vie intérieure peut, à notre insu, ne plus être que le déroulement automatique de pensées acquises, de manières de sentir, acquises, d'actions acquises, une fois pour toutes. On ne crée plus, on répète ce que l'on a dit ou fait hier, ce que l'on fera ou dira demain. Et l'âme individuelle, unique en chacun, cependant, vit dans une constante torpeur : ainsi qu'un membre qui ne remue plus s'ankylose, ainsi la conscience qui ne s'exerce plus par le choix, la décision, l'initiative, l'élan, se bloque. Combien y en a-t-il dans notre société, de ces victimes de l'habitude ?… Demandez-vous, par exemple, quelle sera la force de la pensée, du jugement, chez l'homme condamné à faire, pendant tous les jours de sa vie, les mêmes gestes, identiquement ? La pensée ne tiendra-t-elle pas à imiter des idées toutes faites, comme le corps imite lui-même une action tracée d'avance ? (et voilà bien une proie facile pour les meneurs qui guettent dans l'ombre). Le jeune homme qui vit dans un milieu fermé, étroit, autoritaire, finit, s'il n'y veille, par penser selon ce milieu ses convictions ne sont plus bientôt que le reflet de la société où il vit… Combien de personnes sont éprises de leurs « petites habitudes » au point de ne plus pouvoir quitter leur maison, leur pays, leur milieu, parce qu'il faudrait changer, quelque temps, leur manière de vivre ? Et qu'il en existe des jeunes - des prétendus «jeunes» - dont le triste idéal est un travail de facilité, où on laissera faire toujours le mécanisme de l'habitude : pas d'initiatives, d'abord. Pas d'occasions de prendre une responsabilité : « Se laisser vivre ». Ces esprits précocement séniles finiront bientôt par chérir leurs habitudes plus que tout au monde… Ainsi, des hommes refusent de prendre femme et s'enfoncent dans un perpétuel célibat, amoureux d'abord de leurs habitudes. Ainsi, on arrive à ne plus pouvoir affronter un. risque, si petit soit-il. Bientôt, malgré un visage jeune encore, on a l'esprit d'un vieillard, épris de la petite route définitivement tracée, épris de son confort, vivant avec des «manies» plus chères à son coeur que les êtres vivant alentour. « On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années : on devient vieux parce qu'on a déserté son Idéal, dit le général Mac Arthur. Les années rident la peau ; renoncer à son Idéal ride l'âme. » Même les habitudes acquises doivent être surveillées. Vivant grassement, confortablement sur l'acquis, nous pouvons ne plus chercher à en acquérir de nouvelles or, elles ne doivent jamais nous suffire ! On pourrait citer bien des exemples de gens âgés qui se sont mis à apprendre une langue étrangère, à s'initier à un sport nouveau, à s'intéresser à un tout autre rayon d'action que le leur et qui ont décuplé ainsi leur amour de l'existence, donc leur vitalité. Se connaître, c'est encore mesurer en soi la force de l'habitude. Mais, surtout, il faut essayer de voir clair en nous afin d'être sûrs que certaines habitudes ne risquent pas de nous conduire tout le long de l'existence, sans que nous le sachions. Alexis Carrel, dans L'homme, cet inconnu, conseille d'abord de rompre volontairement, de temps à autre, avec nos habitudes du corps, à seule fin de lui prouver sa force d'adaptation en l'obligeant à affronter des conditions de vie nouvelles. Un organisme qui ne fait plus jamais d'efforts, qui observe chaque jour les mêmes prudentes lois, s'étiole et languit. Et A. Carrel déplore de nous voir utiliser beaucoup moins que nos ancêtres, nos fonctions adaptatives. « Depuis un quart de siècle surtout, dit-il, nous nous accommodons au milieu, par les mécanismes créés par notre intelligence et non par nos mécanismes physiologiques. La civilisation scientifique nous a donné les moyens de conserver notre équilibre intra-organique qui sont plus agréables et moins laborieux que les procédés naturels. Elle a rendu presque invariables les conditions physiques de la vie quotidienne. Elle a standardisé le travail musculaire, l'alimentation, le sommeil. Elle a supprimé l'effort de la responsabilité morale. Il est donc bon de savoir varier ses conditions d'existence : un bon repas, quasi trop copieux, de temps en temps, rompt l'habitude de la tempérance et contraint les organes à un effort inaccoutumé, donc bienfaisant. Avoir faim, avoir soif, avoir froid oblige l'organisme à fournir un effort d'adaptation. « La soif vide les tissus de leur eau, dit encore A. Carrel, le jeûne mobilise les protéines et les matières grasses des organes. Par le passage de la chaleur au froid et du froid à la chaleur, on fait agir les mécanismes si étendus qui règlent la température de l'organisme. » Nous pouvons le dire : l'habitude du bien-être et du confort tend à ankyloser l'esprit au point de le rendre, cet esprit, sédentaire, timoré, épris du moindre effort… Le jeune chef, le scout, l'homme des longues recherches, l'apôtre, le missionnaire, la soeur de charité ne sont pas esclaves des habitudes : ils sont « toujours prêts », selon la belle devise de nos scouts… Faisons donc vivre nos tendances élevées, à coups de volontés fermes, afin qu'elles nous préservent des ankyloses précoces de l'âme… Ne soyons pas un maniaque qui ne peut plus, sans gémir, voir son repas retardé de quelques minutes, ni supporter qu'un objet que la tradition a posé là, sur cette table, à cet endroit précis, soit soudain déplacé de quelques millimètres de son lieu naturel par une main frivole! Si nous nous attachons au passé, sachons au moins que c'est en ce qu'il avait de supérieur à notre temps, et non pour satisfaire la loi du moindre effort, qui est la loi de toute notre nature, cette loi d'inertie, cousine germaine de l'habitude. |
| www.entretiens.ch fait partie du réseau « NETOPERA - culture - société - éducation sur Internet » et pour la photographie PhotOpera - Uneparjour || DEI - Défense des Enfants - International | |
| ROUSSEAU 13: pour allumer les lumières - 300 de Rousseau ROUSSEAU 13: les IMPOSTURES - 300 de Rousseau - portraits déviés | PHOTOGRAPHIE:Nicolas Faure - photographe d'une Suisse moderne - Le visage est une fiction - photographie de l'image brute - Laurent Sandoz - comédien et acteur professionnel - Genève |