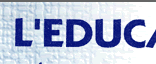
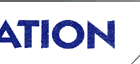



|
ARCHIVES (1997) La politique suisse «de la drogue» La
politique actuelle en matière de toxicomanies fait l’objet
d’un large consensus entre les milieux politiques décideurs
et les divers acteurs sociaux en prise directe avec le problème.
Ceci ne doit pas être une raison pour occulter les débats
de fond qui ont sous-tendu toutes les décisions. Les deux
initiatives populaires pour lesquelles nous voterons en 1997 et
1998, ainsi que des critiques émanant de l’étranger
et de l’intérieur nous donnent l’occasion d’en
discuter. 1)
la prévention: en milieu scolaire, elle privilégie
actuellement l’information dans des cours «d’éducation
à la santé»; elle intègre les informations
spécifiques aux produits dans la discussion des conduites
à risque. Elle cherche ainsi à travailler sur des
images «positives» utiles à la construction de
la personnalité de l’enfant. 2)
la thérapeutique: le principe de base est celui de la multiplicité
des types de prise en charge, qui devrait refléter: 3) l’aide à la survie: pour que les mesures thérapeutiques puissent avoir un impact et un sens il faut prévoir pour des sujets désinsérés un train de mesures qui répondent à l’exigence minimale d’alimentation, de logement, d’occupation, etc. La prévention de maladies mortelles telles que le sida ou les hépatites font partie de ces mesures. 4) la répression: elle a comme but principal de rendre inaccessibles les produits dangereux et interdits, en conformité avec les lois nationales et les conventions internationales. Elle s’adressera donc en priorité aux gros trafiquants. Dans la situation actuelle de «prohibition», tous les actes en rapport avec l’usage des produits restent punissables et prennent une place importante dans le maintien de l’ordre. L’idéologie qui sous-tend cette approche est celle de la solidarité entre la société et un sous-groupe défavorisé caractérisé par sa jeunesse et sa vulnérabilité à l’exclusion. Le principe de réalité est celui qu’une société ne peut pas aller bien si un sous-groupe important devient le symbole et le réservoir de tous les maux médicaux et sociaux. L’analyse des facteurs qui régissent cette situation est d’ordre politique, juridique, économique, moral, ethnologique, historique, etc. La recherche de solution ne peut donc pas procéder de la transcription juridique d’un principe moral, ni d’un article de la Constitution. C’est peut-être la chance de la Suisse d’être un petit pays décentralisé et d’avoir ainsi pu avancer dans un domaine éminemment complexe par petits pas, en restant ouverte à la critique. Tout déséquilibre entre les «quatre axes» met l’ensemble du projet en péril. Dr Gérard Eichenberger |
| Informations
: info@entretiens.ch |
|
| Réalisation
du site: NetOpera/PhotOpera |
|
|
© Entretiens sur |
|